
Exonération de la CSG 2018
Examinons en détail les modalités de cette exonération de la CSG, ainsi que les conditions pour en bénéficier.
Le 27/05/2022 par Jean-Luc Moreau
Ce début d’année 2018 a été marqué par une nouvelle hausse de la Contribution sociale généralisée (CSG), qui passe ainsi de 6,6% à 8,3% pour les retraités. En ce qui concerne le taux réduit, il reste de 3,8%. Quant à l’exonération complète, elle dépend du montant du revenu fiscal de l’avant dernière-année. Entrons maintenant dans les détails.
La CSG, qu’est-ce que c’est ?
La Contribution sociale généralisée (CSG) est une taxe mise en place pour participer au financement de la protection sociale. Concernant l’ensemble des revenus des résidents sur le territoire (métropole et outre-mer), elle est prélevée sur :
- les salaires, primes et indemnités
- les pensions de retraite, allocations chômage
- les revenus fonciers, mobiliers et immobiliers
- les sommes engagées dans les jeux
Captée à la source sur la plupart des revenus concernés, la CSG représente à peu près 100 milliards d’euros de revenus annuels pour la protection sociale, dont 8.3% sont supportés par les retraités.
Exonération et taux réduit : comment en bénéficier ?

Cependant, si ces derniers répondent à différents critères de revenus et d’imposition, ils peuvent être en partie, voire complètement, exonérés de cette taxe.
La réduction de la CSG
Pour y être éligible, le retraité doit avoir un revenu fiscal de référence (de l’avant-dernière année) entre le seuil d’exonération (inférieur au plafond ouvrant des droits à un allègement de la taxe d’habitation) et un plafond fixé à 14 004 euros pour la première part du quotient familiale (+ 3 846 par demi-part supplémentaire).
Dans ce cas et seulement dans ce cas, il peut bénéficier d’un allègement de taxe de 3.8%.
À noter que le plafond est différent pour les territoires d’outre-mer. Il est de 15 757 euros en Guadeloupe, Réunion et Martinique et de 16 507 euros en Guyane.
L’exonération de la CSG
En ce qui concerne l’exonération, y sont admissibles les retraités qui :
- sont bénéficiaires d’une allocation supplémentaire d’invalidité (ASI)
- sont bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA)
- sont bénéficiaires d’une allocation veuvage
- possèdent un revenu fiscal de référence inférieur au plafond fixé pour une part donnée
- sont domiciliés hors du territoire français
Ici encore, le plafond de référence varie en fonction de son lieu d’habitation (métropole, outre-mer).
Les conséquences sociales de la hausse de la CSG

La hausse de la CSG en 2018 a eu un impact significatif sur la vie quotidienne de nombreux Français. Les retraités, en particulier, se sont trouvés face à une pression fiscale accrue, malgré les différentes exonérations et taux réduits offerts. Cela a conduit à une mobilisation de certaines catégories de personnes, en particulier les seniors, qui ont exprimé leur mécontentement face à une décision perçue comme une diminution de leur pouvoir d'achat.
Les effets de la hausse de la CSG ne se sont pas arrêtés à une simple augmentation de la fiscalité. Ils ont également engendré une remise en question de la justice fiscale et de la répartition des charges entre les différentes catégories sociales. Pour certains, cette hausse est venue remettre en question le pacte social qui lie les générations, mettant en lumière les tensions existantes entre actifs et retraités.
L'image d'une CSG augmentée, malgré les différentes mesures d'exonération, a nourri le sentiment d'une pression fiscale toujours plus lourde. Ce sentiment s'est accentué face aux défis économiques auxquels la France était confrontée, tels que le chômage ou la dette publique.
De plus, la communication autour de ces mesures, qu'elle soit en faveur ou contre, a joué un rôle clé dans la perception de la réforme par la population. Certains y ont vu une nécessité pour assurer le financement des services publics, tandis que d'autres ont ressenti cela comme une injustice, en particulier ceux qui étaient directement touchés par la hausse.
Dans ce contexte, il est essentiel d'avoir une vision claire des mécanismes d'exonération et de réduction, et de comprendre leur portée. Les professionnels du secteur peuvent fournir des éclairages pertinents à ceux qui souhaitent en savoir plus et ajuster au mieux leur situation fiscale.
Pour en savoir plus ?
Pour en savoir plus sur votre situation, n’hésitez pas à faire appel à des organes professionnels qui sauront vous conseiller au mieux, comme le site du service public.

Crédits photo : Shutterstock / S. Carpentier

Jean-Luc Moreau
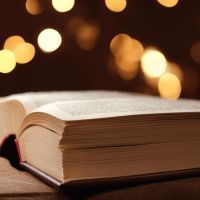
La loi LMNP, ou Loueur en Meublé Non Professionnel, est un dispositif fiscal qui permet aux particuliers de louer leur bien immobilier meublé à des fins de tourisme ou de...

Enjeux et avantages potentiels de cette réforme fiscale controversée.

La loi Pinel est un dispositif fiscal français qui permet aux investisseurs de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu en échange de la mise en location d'un logement neuf...

Découvrons ensemble comment évaluer la rentabilité de cet investissement et comment en tirer le maximum de bénéfices.

Les consommateurs doivent comprendre à quoi sert la TVA et comment elle affecte les produits et leurs achats.
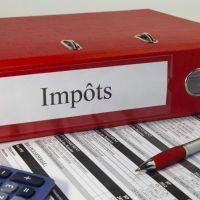
Nous verrons également comment ces taux d'imposition peuvent impacter la situation financière des contribuables et comment ils peuvent être influencés par les différentes politiques fiscales mises en place par les...

Si vous souhaitez en savoir plus sur les différentes options qui s'offrent à vous pour réduire vos impôts et optimiser votre fiscalité, cet article est fait pour vous.

Dans cet article, nous vous proposons de découvrir en détail le fonctionnement du CITE et les conditions à remplir pour en bénéficier.

Découvrez les conditions requises pour être assujetti à la TVA, les différents taux applicables et les obligations comptables à cet égard.
Restez informé de nos dernières actualités et bons plans en vous inscrivant à notre newsletter
- Derniers articles
- Investir en 2025 : pourquoi les SCPI restent la valeur refuge des temps modernes ?
- Assurance responsabilité civile : comprendre l’essentiel
- Top 5 des questions à se poser avant de choisir sa mutuelle santé
- Les clés pour bâtir un patrimoine solide et pérenne
- Travaux déductibles 2024 : guide complet maison
- Comment construire une stratégie patrimoniale cohérente pour sécuriser votre avenir ?










